Des batteries reconditionnées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique
Maxime Bleskine, directeur général et co-fondateur de VoltR, février 2025

Créée en 2022 et incubée par Télécom Paris, VoltR fabrique des batteries bas carbone grâce au reconditionnement de batteries de lithium usagées. Comment le réemploi permet-il de réduire l’empreinte environnementale du numérique ?
Parlons avec Maxime Bleskine, directeur général et co-fondateur de VoltR, des enjeux de la création d’une économie circulaire des batteries au lithium, d’abord pour améliorer l’impact environnemental et social de cette industrie, puis pour tenter de réduire la dépendance européenne à ses composants, notamment vis-à-vis de l’Asie.
Propos recueillis par Isabelle Mauriac
Podcast
Retrouvez cette interview en format audio dans le cadre des podcasts Télécom Paris Ideas :
Podcast Michel Desnoues, Télécom Paris
Des batteries réemployées
Nous avons développé une activité reposant sur deux axes. Le premier consiste à proposer des services de collecte aux industriels possédant des batteries usagées afin de les récupérer, de les analyser et de les acheminer jusqu’à notre centre de traitement basé à Angers. Le second axe de notre activité concerne la revalorisation de ces batteries, ou réaffectation, selon la terminologie officielle.
Cela consiste à les démanteler pour atteindre les cellules, les composants unitaires de base des batteries. C’est à cet endroit que s’effectue véritablement le stockage de l’énergie, et c’est là que se trouvent tous les métaux critiques qui suscitent actuellement beaucoup d’attention.
Cela nous permet ensuite de les rediriger vers une application de seconde vie appropriée et de les réassembler dans de nouveaux packs, que nous commercialisons auprès d’industriels intégrateurs fabriquant des équipements nécessitant une batterie pour fonctionner.
C’est un chiffre à prendre avec précaution, car il est très difficile aujourd’hui d’obtenir des données précises sur l’amont de la filière. Les fabricants de batteries publient peu leurs chiffres. Cependant, cette moyenne reste une référence pertinente. Ainsi, 80% de l’empreinte carbone globale d’une batterie proviennent de la fabrication de la cellule, incluant l’extraction et le raffinage des matières premières nécessaires à sa production.
Par matières premières, on entend les métaux critiques, notamment le cobalt, le manganèse, le lithium et le graphite. En effet, ces éléments, en particulier le lithium, le nickel et le cobalt, posent d’importants enjeux environnementaux.
Exactement : l’opportunité sur laquelle repose notre approche vient du constat qu’en moyenne, une cellule considérée comme obsolète pour son application de première vie et envoyée au recyclage n’a en réalité utilisé que 20% de ses performances. Autrement dit, elle conserve encore 80% de sa capacité de stockage. Détruire ces cellules serait donc un véritable gâchis, d’autant plus que le recyclage est un procédé destructeur, énergivore et générateur d’une empreinte carbone non négligeable.
Il est donc essentiel de créer un maillon supplémentaire dans la chaîne de valeur, qui précède le recyclage : le réemploi.
Il existe plusieurs manières de réemployer une batterie, comme c’est le cas pour d’autres types de produits. Cependant, ce réemploi doit impérativement être privilégié avant le recyclage, sans pour autant s’y substituer. Un produit réemployé une, deux ou trois fois, finira toujours par atteindre un stade où il ne pourra plus être utilisé, et il sera alors recyclé. L’enjeu majeur est donc d’optimiser cette chaîne de valeur pour en maximiser l’efficacité.
L’apport de l’IA
Pour bien comprendre, il faut repartir de la barrière technologique que nous avons levée. Le principal défi est qu’une batterie vieillit et se dégrade progressivement avec le temps et l’usage. Lorsqu’une batterie arrive en fin de première vie, il est relativement simple d’en évaluer la performance résiduelle, c’est-à-dire principalement sa capacité résiduelle et sa résistance interne. Ces paramètres peuvent être déterminés grâce à des tests de cyclage.
Cependant, connaître ces valeurs à un instant T ne suffit pas. Deux cellules issues de la même usine, de même référence et ayant été utilisées pour une même application ne se comporteront pas nécessairement de la même manière en seconde vie. Cela s’explique par le fait qu’elles n’ont pas forcément été soumises aux mêmes conditions d’utilisation en première vie. De plus, lorsque nous récupérons une batterie usagée, nous ne disposons pas d’un historique précis de son utilisation. Il est donc nécessaire de reconstituer artificiellement cette première vie pour pouvoir prédire la seconde.
Pour ce faire, nous avons développé des bases de données d’entraînement. Nous avons soumis des cellules à des cycles de vieillissement accéléré en laboratoire, en reproduisant diverses conditions d’usage. Cela nous a permis de constituer une base de données conséquente, sur laquelle repose notre intelligence artificielle.
Quelles applications ?
Je réfute complètement l’idée de la baisse supposée et systématique des performances lorsqu’une batterie est utilisée en seconde vie ; je vais vous donner un exemple simple pour illustrer cela.
Lorsque vous achetez un smartphone, vous vous attendez à ce qu’après une charge complète durant la nuit, il fonctionne toute la journée. Mais après une ou plusieurs années d’utilisation, il se peut qu’à 17h, après une charge complète, il soit déjà déchargé. Que faites-vous alors ? Vous changez soit de smartphone, soit uniquement de batterie. Pourtant, la batterie usagée, bien qu’elle ne soit plus suffisante pour alimenter votre smartphone toute la journée, fonctionne toujours : elle permet encore une utilisation de 8h à 17h.
Nous récupérons donc ces cellules et les redirigeons vers une application de seconde vie moins exigeante en autonomie et en performance ; par exemple, un terminal de paiement électronique qui ne nécessite qu’une autonomie d’environ une heure.
Une batterie qui affiche 80% de sa performance initiale sur son application de première vie peut en réalité atteindre 120% de performance sur une application de seconde vie moins exigeante. C’est là toute l’ingéniosité du processus. Ainsi, nous sommes en mesure de proposer des produits aussi performants que ceux issus de l’industrie linéaire, simplement en les réorientant vers les bonnes applications.
Aujourd’hui, nous intervenons sur deux principaux marchés. Le premier est celui de la mobilité légère, qui comprend les trottinettes, les scooters et les vélos électriques. Le second concerne les applications électroniques portables, toutes les batteries de petite puissance qui ne sont pas destinées à déplacer des biens ou des personnes. Cela inclut, par exemple, l’outillage électroportatif, les terminaux de paiement électronique, l’électroménager autonome, etc.
Aujourd’hui, VoltR propose une dizaine de modèles de batteries certifiées, disponibles sur le marché, qui répondent à ces différents besoins. Nous avons ainsi pu établir des correspondances précises entre les batteries récupérées et les applications adaptées à leurs performances résiduelles.
Quel impact écologique ?
Comme évoqué précédemment, 80% de l’empreinte carbone d’une batterie proviennent de la fabrication de la cellule. Or, chez VoltR, nous fabriquons des batteries exclusivement avec des cellules de seconde vie. Cela signifie que nous nous affranchissons, en grande partie, de cette empreinte écologique en réutilisant des cellules existantes.
Bien sûr, il s’agit d’une simplification, car notre activité de réemploi implique certains processus qu’un fabricant de batteries neuves n’a pas. Pour obtenir des chiffres précis, il est donc nécessaire de réaliser une analyse de cycle de vie (ACV). Nous sommes actuellement en train de mener cette étude afin d’établir des données fiables et consensuelles. Un panel d’experts travaille sur les hypothèses retenues, mais l’exercice n’est pas encore finalisé.
Cependant, l’empreinte carbone n’est pas toujours l’indicateur le plus pertinent lorsqu’il s’agit des batteries. Deux autres aspects cruciaux sont à considérer :
- L’extraction des ressources naturelles, qui entraîne une raréfaction progressive de certains matériaux essentiels.
- La consommation d’eau, car l’industrie minière est extrêmement gourmande en eau.
Aujourd’hui, dans certaines régions du monde où l’on extrait le lithium et le cobalt, comme en République démocratique du Congo ou en Australie, la pression hydrique est une problématique majeure. Ces zones souffrent déjà d’un accès limité à l’eau, et l’extraction intensive de ces métaux ne fait qu’aggraver la situation.
Enjeux de souveraineté
Nous assistons actuellement à une croissance rapide du marché du stockage d’énergie, qui repose principalement sur deux grandes tendances :
1. L’électrification des usages, en particulier dans le domaine de la mobilité, qu’elle soit douce, légère ou lourde.
2. La transition énergétique, qui nécessite une capacité massive de stockage d’énergie pour pouvoir remplacer progressivement la production issue des énergies fossiles par des énergies renouvelables.
L’un des défis majeurs des énergies renouvelables est leur désynchronisation avec la demande énergétique. Par exemple, l’énergie solaire photovoltaïque est principalement produite autour de 14 heures, alors que nos besoins en consommation (comme pour faire tourner une machine à laver) se situent plutôt en soirée, vers 22 heures. D’où la nécessité de développer des solutions de stockage efficaces.
En conclusion, si l’on veut poursuivre la transition énergétique et accélérer l’électrification des usages en Europe, il est essentiel de réduire notre dépendance vis-à-vis des grandes puissances qui dominent actuellement ce marché, notamment la Chine.
L’ensemble de la filière se divise en trois grandes étapes : la première vie des batteries, le réemploi (ou seconde vie) et le recyclage.
En Europe, d’importants efforts ont été réalisés ces dix à quinze dernières années pour développer l’industrie de la première vie des batteries, avec l’émergence d’acteurs majeurs comme Northvolt ou ACC. Parallèlement, des avancées significatives ont été faites dans le domaine du recyclage, même si de nombreux défis restent à relever et que l’Europe accuse encore un certain retard, comme l’actualité récente l’illustre.
Concernant le réemploi, c’est un paradoxe intéressant : moins d’efforts ont été investis, et pourtant, l’Europe est aujourd’hui en avance sur ce sujet. En effet, l’économie circulaire est un domaine où l’Europe a historiquement pris de l’avance, non seulement pour les batteries mais aussi pour d’autres secteurs industriels.
C’est à cette condition que l’Europe pourra véritablement devenir un pôle d’excellence du réemploi des batteries et affirmer son indépendance face aux grandes puissances concurrentes.
La réponse est à la fois oui et non. Ce que vous qualifiez de secousses sont avant tout des événements conjoncturels, et non structurels. Si Northvolt traverse des difficultés, cela ne signifie pas nécessairement que toute la filière est en crise ; il s’agit plutôt d’un acteur spécifique confronté à des défis particuliers.
Cela dit, Northvolt n’est pas le seul concerné, ce qui indique que certaines tendances rendent la situation plus complexe que prévue. Trois grandes problématiques semblent faire consensus aujourd’hui parmi les grands acteurs du secteur :
1. Une forte dépendance à l’industrie automobile, qui constitue leur principal marché. Or, cette industrie connaît actuellement des difficultés en Europe, ce qui impacte directement la demande en batteries.
2. Des problèmes de chaîne d’approvisionnement, car une grande partie des ressources nécessaires à la fabrication des batteries provient de l’étranger, notamment d’Asie.
3. Une difficulté à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, ce qui est particulièrement vrai pour Northvolt, qui a voulu se diversifier sur de nombreux segments en même temps. Or, en industrie, il est difficile de se développer sur plusieurs fronts à la fois, surtout lorsque les coûts de production en Europe restent élevés par rapport à la concurrence internationale.
À l’inverse, chez VoltR, nous ne sommes pas positionnés sur le marché des batteries pour véhicules électriques, ce qui nous met à l’abri des turbulences de cette industrie. De plus, nous n’avons pas de pression sur les ressources, puisque notre matière première provient du gisement de déchets en Europe. Enfin, en termes de compétitivité, nous bénéficions d’un avantage économique majeur : de la même manière que la cellule représente 80% de l’empreinte écologique d’une batterie, elle représente également 80% de son coût de revient.
Cela dit, il est évident que nous avons besoin d’une filière solide pour la première vie des batteries afin de garantir un gisement de cellules reconditionnables en seconde vie. Il est donc crucial que les acteurs de la première vie puissent surmonter cette période difficile. D’ailleurs, tout n’est pas négatif : un article récent (début 2025) annonce trois nouveaux projets industriels à Dunkerque en matière de recyclage, de raffinage et de construction de batteries. Ces initiatives montrent que des dynamiques positives sont également à l’œuvre en Europe.
Quels cibles commerciales ?
Le passage à l’échelle implique une croissance simultanée sur tous les aspects de notre activité. Dans l’économie circulaire, cela est particulièrement complexe, car, contrairement à l’industrie linéaire, nous ne maîtrisons pas totalement nos flux entrants. Nous ne pouvons pas simplement passer commande pour un nombre précis de batteries usagées.
Cela étant dit, nous avons beaucoup travaillé à sécuriser notre gisement. Aujourd’hui, nous sommes identifiés comme un acteur-clé en France et en Europe, notamment auprès des détenteurs de batteries usagées et des éco-organismes avec qui nous avons noué des partenariats. Cette reconnaissance nous permet d’avoir un afflux important de batteries, au point que nous devons parfois refuser certaines opportunités de collecte, faute de capacités de traitement suffisantes. Notre objectif est donc clair : obtenir les ressources nécessaires pour pouvoir accélérer et franchir ce cap industriel.
Il existe un véritable enjeu structurel, qui ne concerne pas seulement notre secteur mais toutes les jeunes entreprises industrielles. Nous devons sans cesse naviguer sur une ligne de crête :
- D’un côté, nos moyens de production actuels ne nous permettent pas encore de satisfaire les volumes exigés par de grands industriels. Un client ne nous commandera pas 10 batteries, mais plutôt 10 000 ou 100 000 d’un coup, ce qui est un défi pour une jeune entreprise comme la nôtre.
- D’un autre côté, sans ces commandes, nous ne pouvons pas justifier les investissements nécessaires à notre montée en puissance ni attirer de nouveaux financements.
Heureusement, l’attraction commerciale est forte. D’une part, le marché du reconditionnement des batteries est en pleine expansion. D’autre part, notre proposition de valeur est particulièrement attractive, même en dehors de son impact environnemental :
- Nos batteries sont performantes et de haute qualité.
- Elles sont compétitives face à celles produites en Asie.
- Elles offrent une meilleure flexibilité logistique, car nous sommes implantés en Europe et pouvons fournir nos clients bien plus rapidement qu’un acteur asiatique.
Nous ne vendons pas directement aux particuliers, donc nous ne pouvons pas fournir une batterie à qui souhaite électrifier sa trottinette thermique. Cependant, il est évident que le changement doit venir des consommateurs.
Déjà, je conseillerais de privilégier une trottinette mécanique si possible, car l’électrification, bien qu’elle soit préférable aux carburants fossiles, reste une solution intermédiaire qui ne doit pas remplacer les modes de transport actifs lorsque ceux-ci sont adaptés.
Ensuite, en tant que consommateur, il faut se tourner vers des entreprises engagées dans une démarche responsable. Par exemple, si vous achetez une trottinette électrique, renseignez-vous sur son bilan environnemental :
- Le fabricant utilise-t-il une batterie issue du réemploi ?
- Mène-t-il des initiatives en matière d’éco-conception ?
C’est un point crucial : avant de penser au réemploi, il faut concevoir des produits réparables et durables. Une seconde vie n’a de sens que si la première est optimisée. Aujourd’hui, de nombreux produits sont fabriqués sans possibilité de réparation, ce qui pose un problème majeur.
Sur la batterie elle-même, hélas non, parce que c’est un marché encore très jeune, donc il n’existe pas encore d’initiative de ce côté. Mais notre feuille de route inclut la structuration des labels de qualité de la filière européenne du réemploi. Sur d’autres types de produits, certaines initiatives sont lancées par différentes fédérations professionnelles du réemploi, notamment RCube et le SIRRMIET qui visent à mettre en œuvre le label RecQ dédié au reconditionné ; cela concernera typiquement les smartphones et les ordinateurs portables. Cette belle initiative permettra aux acheteurs de téléphones reconditionnés de connaître leurs conditions de fabrication.
Vidéos
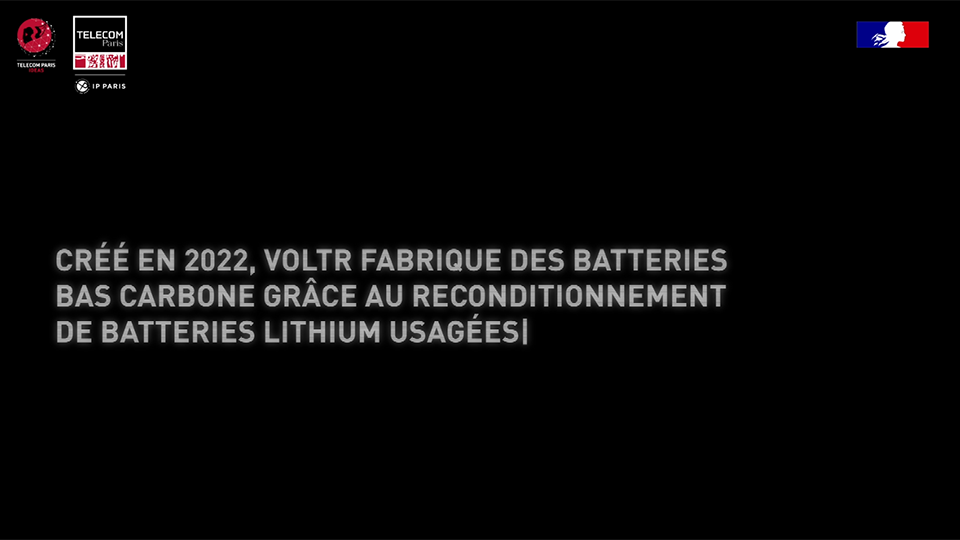
Le reconditionnement de batteries est une manière cruciale de réduire l’empreinte environnementale du numérique. Maxime Bleskine, directeur général et co-fondateur de VoltR, répond à nos questions sur les enjeux autour de la création d’une économie circulaire des batteries de lithium.
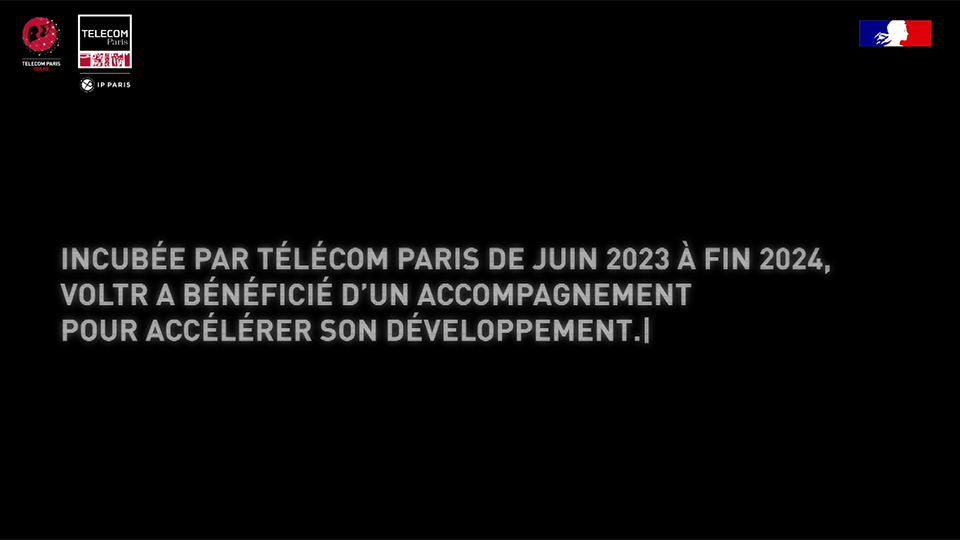
Incubée par Télécom Paris en 2023-2024, VoltR a bénéficié d’un accompagnement pour accélérer son développement.
Vidéos Michel Desnoues, Télécom Paris
